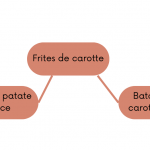Prendre rendez-vous
Merci de bien vouloir indiquer les motifs de la consultation dans la partie « message ».
En payant, vous acceptez les CGV. Toute consultation annulée moins de 48h à l’avance sera due.
Le prix des consultations à domicile peuvent varier selon le temps de trajet : 5€ (< 10min) à 20€ (= 30 min), voire plus si supérieur à 30 minutes. Plus d’informations en me contactant.